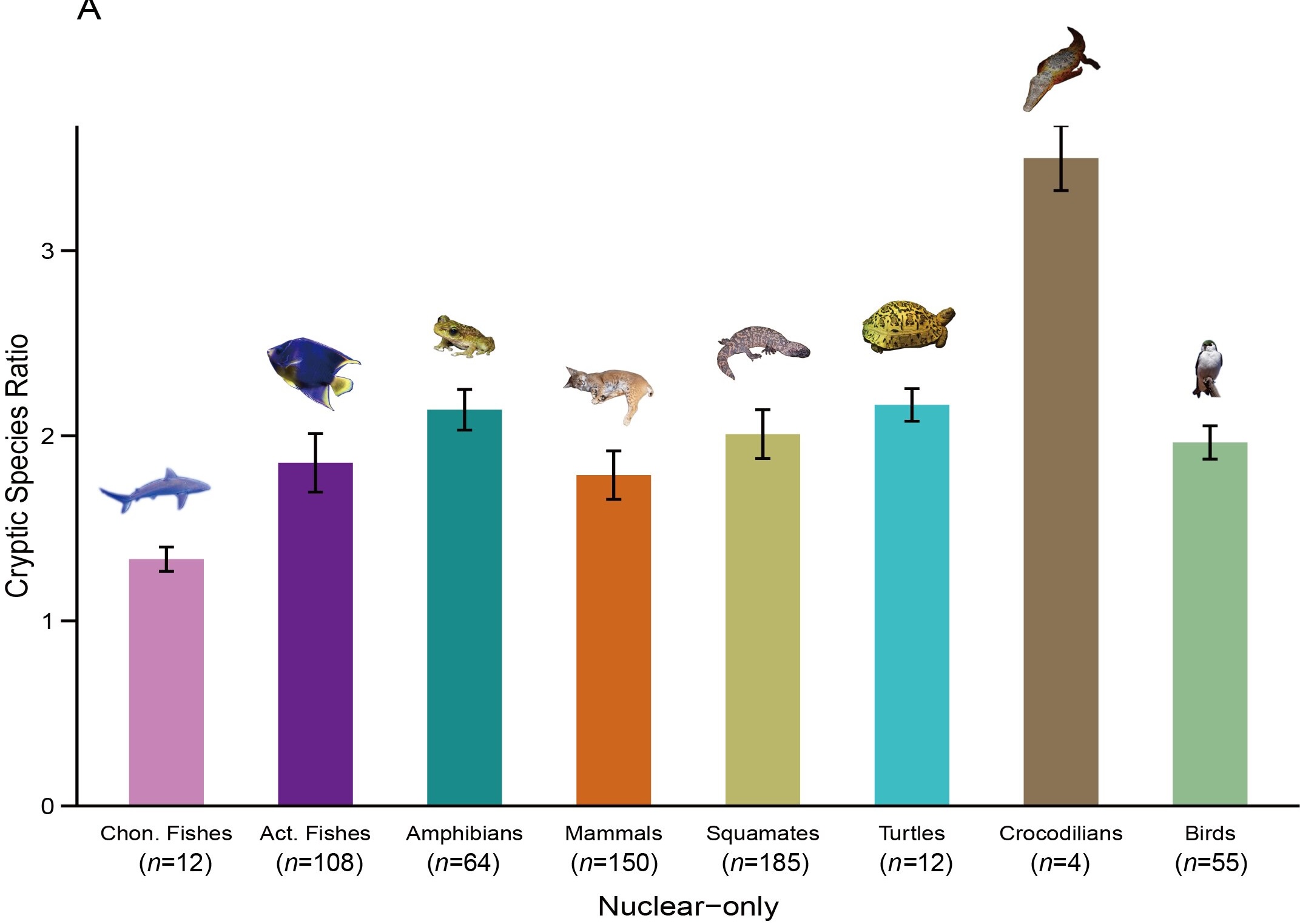Quand la science s’emmêle les pinceaux : l’étrange affaire de la grenouille à deux noms
Auteur: Adam David
Une identité volée pendant des décennies

C’est une histoire qui ferait presque sourire si elle ne concernait pas la rigueur scientifique. Imaginez une petite grenouille venimeuse, cachée dans la moiteur de la forêt péruvienne, qui a vécu sa vie… sous un faux nom. Pendant des décennies, les chercheurs, persuadés d’avoir affaire à une espèce unique, l’ont cataloguée comme étant la Dendrobates duellmani. Un nom qui sonne bien, n’est-ce pas ? Sauf qu’il était faux. Complètement faux.
Il a fallu que des chercheurs fouillent dans les collections poussiéreuses d’un Musée d’histoire naturelle pour lever le voile sur ce quiproquo. En réalité, cette petite bête appartient à une espèce que l’on connaissait déjà très bien : la Ranitomeya ventrimaculata. Eh oui, tout ça pour ça. On pensait avoir une espèce spécifique, rare peut-être, mais les analyses ont prouvé qu’elle faisait partie d’un groupe déjà répertorié. C’est un peu comme découvrir que votre voisin mystérieux est en fait… votre cousin éloigné.
Cette confusion, récemment clarifiée, est loin d’être anecdotique. Elle jette un pavé dans la mare des taxonomistes. Ces nouveaux résultats nous rappellent assez brutalement qu’on ne peut pas — ou plutôt qu’on ne devrait plus — se contenter de simples photos pour identifier une espèce. La nature est trop complexe pour se laisser capturer par un seul cliché, aussi beau soit-il.
L’holotype : la référence absolue (ou presque)
Pour bien comprendre comment une telle boulette est possible, il faut que je vous parle de ce qu’on appelle l’holotype. C’est un terme un peu barbare, je vous l’accorde, mais c’est la clé de voûte de la biologie. En gros, quand on découvre une nouvelle espèce, on choisit un spécimen unique — un seul ! — qui servira de référence universelle pour décrire et nommer le taxon. C’est le mètre étalon. C’est à partir de lui que toutes les caractéristiques morphologiques sont décrites.
Mais attention, il y a un piège. L’holotype n’est pas forcément le plus beau spécimen, ni le plus complet, ni même le plus représentatif de l’espèce. Non, c’est souvent juste le premier qu’on a trouvé et qui ne ressemblait à rien de connu. Tenez, prenons l’exemple célèbre de l’espèce humaine ancienne, Australopithecus afarensis. Tout le monde connaît Lucy, n’est-ce pas ? Eh bien, figurez-vous que Lucy n’est pas l’holotype ! L’holotype qui a permis de décrire l’espèce est le spécimen LH 4, une mâchoire découverte à Laetoli en 1975. C’est fou quand on y pense, on se base sur une référence qui est parfois moins complète que les découvertes ultérieures.
Si autrefois, les holotypes étaient toujours des bouts d’animaux ou des spécimens entiers conservés dans l’alcool, la pratique a… disons, évolué. Parfois un peu trop vite. Aujourd’hui, certains biologistes incluent des photos, de l’ADN ou même des témoignages de communautés locales dans ce qu’ils considèrent comme l’holotype. Ana Motta, professeure d’herpétologie à l’Institut de la biodiversité de l’Université du Kansas, l’explique très bien : « Lorsqu’on décrit une espèce, on lui attribue un spécimen de référence qui porte son nom ». Si elle trouve une autre grenouille plus tard, elle doit revenir à cet holotype pour comparer. C’est le juge de paix. Sauf quand le juge se trompe.
L’erreur du code-barres et la photo trompeuse

C’est là que l’histoire devient rocambolesque. Ana Motta et ses collègues ont mis le nez dans la collection du Musée d’histoire naturelle de l’Université du Kansas et ont réalisé que l’holotype de notre fameuse grenouille venimeuse péruvienne était… une imposture. Enfin, pas l’animal lui-même, mais son étiquetage. D’après leurs travaux, publiés dans la très sérieuse revue Zootaxa, la soi-disant Dendrobates duellmani est bel et bien une Ranitomeya ventrimaculata, une grenouille amazonienne classique.
Tout a commencé en 1999. La grenouille a été décrite pour la première fois non pas avec le spécimen en main, mais à partir d’une simple photographie prise dans la forêt tropicale péruvienne, tout près de la frontière avec l’Équateur. Déjà, décrire une espèce juste avec une photo, c’est une pratique controversée vis-à-vis du Code international de nomenclature zoologique. Mais le chercheur de l’époque, ne pouvant pas identifier la bête avec certitude, a foncé. La photo avait été déposée dans la collection sous la référence KU 221832.
Et c’est là que le drame administratif arrive. Comme l’explique Ana Motta, chaque spécimen a un numéro de catalogue, « C’est comme un code-barres ». Tout est lié à ce numéro : l’ADN, les photos, le son du cri… Le chercheur, en voyant la photo, a demandé le numéro de catalogue. On lui a donné le numéro… mais c’était le mauvais ! Il a reçu le numéro d’un autre spécimen. Résultat des courses : il a associé sa description d’une nouvelle espèce colorée à un spécimen qui n’avait rien à voir.
L’erreur est restée invisible pendant des années. Ce n’est que bien plus tard, quand d’autres herpétologues ont voulu examiner l’holotype physique pour comparer des espèces apparentées, qu’ils ont halluciné. Ils ont reçu le bocal correspondant au numéro, et surprise : la grenouille dedans était brune, alors que celle décrite sur la photo d’origine était très colorée ! On sait aujourd’hui que des espèces peuvent se ressembler morphologiquement mais être différentes (espèces cryptiques), mais l’inverse est vrai aussi : ces deux grenouilles, la brune et la colorée, partagent en fait le même patrimoine génétique. C’était la même espèce depuis le début.
Leçon d’humilité pour la science moderne

Au final, cette aventure taxonomique nous apprend pas mal de choses. Selon la chercheuse Ana Motta, cela prouve qu’on ne peut pas se passer des collections muséales physiques. Le virtuel a ses limites. Il faudrait peut-être repenser la définition de l’holotype pour aller vers un « spécimen étendu », qui inclurait le corps physique mais aussi les chants, l’ADN et les photos. Un package complet, quoi.
Surtout, cette étude tire la sonnette d’alarme : se baser uniquement sur une photo pour dire « Hé, j’ai trouvé une nouvelle espèce ! », c’est risqué. Très risqué. Ce genre d’erreur peut se propager dans les manuels pendant des décennies. Pour Ana Motta, la conclusion est sans appel : « Il est essentiel de travailler directement avec le spécimen, car c’est à partir de lui que l’on peut confirmer les observations ». Sans le corps physique, la recherche n’est pas reproductible. Et une science qu’on ne peut pas vérifier… eh bien, ce n’est plus tout à fait de la science, je suppose.
Ce contenu a été créé avec l’aide de l’IA.